Comprendre la servicisation à travers la logique dominante de service : une nouvelle approche pour les opérations

Pourquoi parle-t-on autant de servicisation aujourd’hui ?
Les entreprises industrielles sont confrontées à une forte pression : leurs marchés sont souvent saturés, leurs marges se réduisent, et la concurrence devient mondiale. Dans ce contexte, proposer des services associés aux produits (SABE) – autrement dit, s’engager dans la servicisation (ou servitisation) – est devenu une stratégie incontournable pour rester compétitif.
Mais cette transformation n’est pas simple. Elle implique de repenser la manière dont on conçoit la valeur, les relations avec les clients et l’organisation même des opérations. L’objectif de ce document est d’expliquer comment la logique dominante de service (S-D Logic) peut aider à mieux comprendre les défis et à accompagner la mise en œuvre de cette servicisation.
1. De quoi parle-t-on ? Produit, service… ou les deux à la fois ?
Dans le modèle économique classique, les entreprises fabriquent un bien, le vendent, et le client s’en sert de manière autonome. On parle ici d’une logique dominante de biens (G-D Logic). Mais ce modèle atteint ses limites.
Avec la servitisation, on change de paradigme : il ne s’agit plus seulement de vendre un bien, mais de proposer un système combiné produit + service, qu’on appelle PSS (Product-Service System). Ce système peut aller de la simple maintenance à des offres où le client paie pour une performance ou un résultat (par exemple : payer à l’heure de fonctionnement d’un moteur plutôt que d’acheter le moteur).
Cela bouleverse profondément les relations entre fournisseurs et clients, car la valeur ne réside plus dans l’objet vendu, mais dans l’usage réel qu’en fait le client.
2. La S-D Logic : une autre manière de penser la valeur
La S-D Logic, développée par Vargo et Lusch, repose sur plusieurs idées fondamentales :
- La valeur est co-créée : elle n’est pas produite en usine, mais générée dans l’interaction entre le client et le fournisseur.
- Le client n’est pas un simple récepteur, mais un véritable acteur dans la production de valeur.
- Les produits sont des supports de service : un produit ne vaut que par les services qu’il permet de rendre.
- Les ressources sont intégrées : la valeur vient de la combinaison des compétences, outils, informations, contexte, etc.
Cette vision est bien différente de celle centrée sur l'efficacité de production. Elle oblige les entreprises à se centrer sur l’expérience d’usage.
3. Étude de cas : comment une entreprise industrielle a transformé son modèle
Les auteurs s’appuient sur l’analyse détaillée d’un équipementier industriel britannique qui a profondément transformé son activité en quelques années. Voici les grandes étapes de cette transformation :
- Initialement, l’entreprise vendait des machines avec un service après-vente classique.
- Elle a progressivement intégré des contrats de maintenance, puis des contrats de disponibilité, et enfin des engagements sur des résultats opérationnels (ex : production garantie, performance attendue).
- Ce changement a nécessité une nouvelle organisation, des outils de suivi différents, et une collaboration renforcée avec les clients.
L’objectif de l’étude est d’analyser les différentes propositions de valeur développées par l’entreprise, et leur impact sur la gestion des opérations.
4. Les quatre types de propositions de valeur dans un système produit-service
L’étude identifie quatre propositions de valeur différentes mais souvent combinées dans la réalité. Elles correspondent à différents niveaux d’engagement du fournisseur et du client.
a. La valeur centrée sur le produit (Asset Value Proposition)
C’est le modèle le plus classique : le client achète un produit, et il en tire lui-même la valeur via son usage. Le fabricant garantit un bon fonctionnement initial, mais n’a pas de responsabilité sur la performance dans le temps.
Exemple : vendre une imprimante industrielle.
b. La valeur de récupération (Recovery Value Proposition)
Ici, le fournisseur s’engage à intervenir en cas de panne. Il garantit une capacité de réparation rapide, mais pas la prévention. Le service est réactif, avec un niveau variable d’urgence.
Exemple : contrat de réparation sous 24h en cas de panne.
c. La valeur de disponibilité (Availability Value Proposition)
Le fournisseur garantit que l’équipement sera disponible à tout moment. Cela implique de la maintenance préventive, du monitoring, et une connaissance fine des usages du client.
Exemple : garantir 98 % de disponibilité annuelle.
d. La valeur de performance (Outcome Value Proposition)
C’est le niveau le plus avancé : le client paie pour un résultat final (ex : nombre de pièces produites, efficacité énergétique, absence de défauts), sans se soucier des moyens techniques.
Cela suppose une collaboration étroite et une forte personnalisation du service.
Exemple : contrat de “pay-per-use” ou de “performance garantie”.
5. La variété contextuelle d’usage : le défi caché
Un point fondamental mis en lumière dans l’article est la notion de variété contextuelle d’usage. Plus on monte en complexité dans la proposition de valeur, plus cette variété devient importante.
Concrètement, cela signifie que :
- Un même produit peut être utilisé de manière très différente d’un client à l’autre.
- L’environnement (humain, physique, technique) joue un rôle crucial dans la performance.
- Le fournisseur doit apprendre à absorber cette variété, ce qui est très difficile avec des processus standardisés.
Cela oblige l’entreprise à intégrer le client comme une ressource active dans le processus de service.
6. Les impacts sur l’organisation des opérations
Passer à un modèle PSS ne peut pas se faire sans adapter profondément les pratiques opérationnelles. L’étude montre plusieurs évolutions nécessaires :
a. Repenser les processus internes
- Il faut passer de processus rigides à des systèmes agiles et flexibles, capables de s’adapter à chaque client.
- La standardisation est remplacée par la personnalisation raisonnée.
b. Organiser différemment le travail
Selon la proposition de valeur, le rôle des techniciens, ingénieurs et commerciaux change :
- Dans les modèles “produit” : tâches simples, règles claires.
- Dans les modèles “résultat” : travail collaboratif, résolution de problèmes, coordination avec le client.
c. Créer une culture de la co-production
Les équipes doivent apprendre à travailler avec le client, à partager les informations, à prendre en compte le contexte d’usage. Cela suppose aussi un changement culturel profond.
7. Une vision dynamique et imbriquée des propositions de valeur
Contrairement à ce que l’on pense souvent, les propositions de valeur ne forment pas une progression linéaire. Dans la réalité :
- Elles coexistent dans les entreprises.
- Elles s’appuient les unes sur les autres (ex : pour garantir un résultat, il faut une bonne disponibilité, donc un bon service de réparation).
- Elles nécessitent des systèmes hybrides et adaptables, capables de gérer plusieurs logiques à la fois.
Cela renforce l’idée que la servicisation n’est pas un modèle unique, mais une constellation de modèles imbriqués.
8. Implications managériales : comment réussir sa transformation servicielle ?
L’article fournit des pistes concrètes pour les dirigeants souhaitant réussir leur transition vers des systèmes orientés service :
a. Investir dans la compréhension du client
Il faut aller au-delà des besoins fonctionnels pour comprendre les attentes, les usages réels, les contraintes opérationnelles. Cela suppose de la proximité, de l’écoute et du dialogue continu.
b. Repenser les indicateurs de performance
On ne peut plus se contenter de mesurer des temps de réponse ou des taux de pannes. Il faut intégrer des indicateurs d’usage, d’expérience, de co-production, et parfois même des indicateurs propres au client.
c. Reconfigurer les systèmes d’information
Les systèmes doivent permettre de suivre l’usage, d’anticiper les pannes, de documenter les interactions, et de piloter des contrats complexes.
d. Reformer les équipes
Les compétences techniques ne suffisent plus. Il faut aussi des compétences relationnelles, collaboratives, analytiques.
9. Un nouveau regard sur le PSS : vers un système vivant de service
En conclusion, les auteurs invitent à repenser le PSS non pas comme une simple combinaison produit + service, mais comme un “système de service vivant”, c’est-à-dire :
- Co-construit avec le client
- Evolutif dans le temps
- Adapté aux contextes d’usage
- Porté par une logique de coproduction de la valeur
Cela rejoint la S-D Logic, selon laquelle la valeur ne préexiste pas mais se crée dans l’interaction, dans l’usage, dans la relation.
Conclusion
La servicisation n’est pas une mode mais un changement de paradigme. Elle invite les entreprises industrielles à :
- Penser en termes d’usage, pas seulement de produit
- Co-construire la valeur avec leurs clients
- Réinventer leurs processus opérationnels
Le passage de la logique de biens à la logique de service est une révolution silencieuse mais profonde, qui touche autant la stratégie, l’organisation, la culture que les outils. C’est une voie exigeante, mais aussi porteuse de résilience, d’innovation et de fidélisation durable.
Prêts à développer une stratégie de Croissance Servicielle ?
Êtes-vous prêts à donner un nouvel élan à votre entreprise, à travers une approche orientée Services, une relation clients singulière et fidélisante, un modèle économique disruptif et en phase avec votre politique RSE, une politique managériale adaptée à toutes les générations, une performance commerciale revisitée et durable, et/ou des coopérations clients-fournisseurs-partenaires inédites et à forte valeur ajoutée ?
Chez Service&Sens, nous sommes là pour vous guider dans le développement de votre stratégie de croissance sur mesure, en transformant chacun de vos défis en opportunités concrètes, portées par vos équipes.
Abonnez-vous à Transform'Action News, notre newsletter incontournable !
En vous abonnant, vous aurez un accès privilégié à un monde d'avantages. Tous les deux mois, nous vous partagerons des contenus exclusifs, des analyses prospectives, des actualités de l'industrie, des conseils d'experts et bien plus encore.
Rejoignez notre communauté dynamique et enrichissante dès maintenant en vous abonnant à notre newsletter.
C'est rapide, facile et gratuit. Et souvenez-vous, l'information est le pouvoir.

D'autres articles sur le même sujet
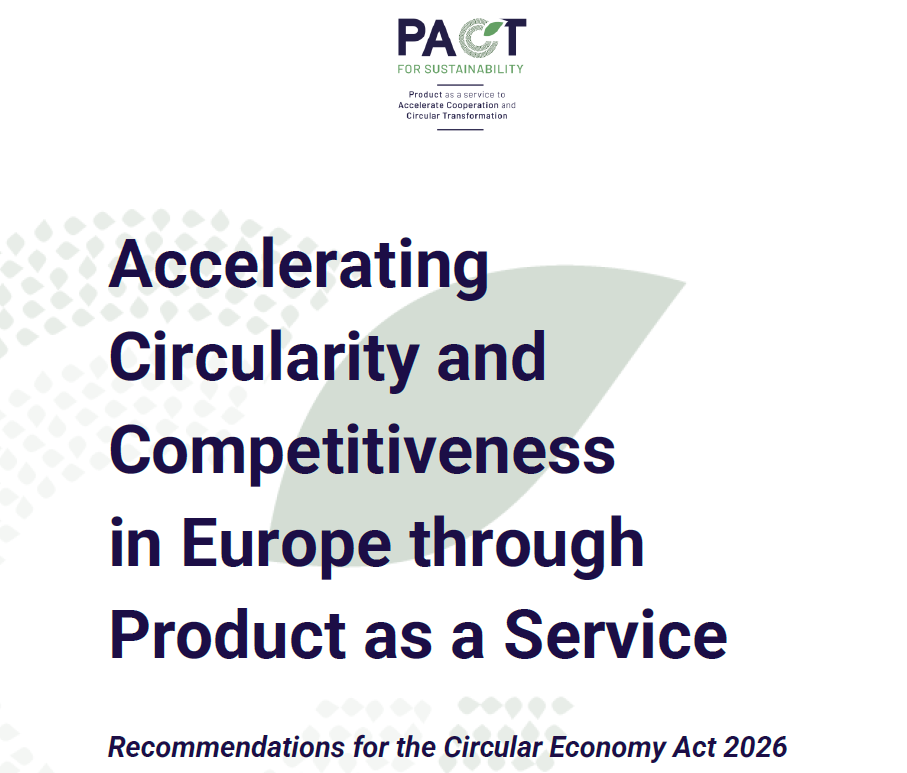
Accélérer la circularité et la compétitivité en Europe grâce au modèle « produit en tant que service »
Juin 2025 : Note d'orientation « Accélérer la circularité et la compétitivité en Europe grâce au modèle « produit en tant que service » Alors que l'UE vise à doubler son taux de circularité, le faisant passer de 12 % à 24 % d'ici 2030, cette note d'orientation souligne comment les modèles économiques de type « produit en tant que service » (PaaS) peuvent jouer un rôle clé en combinant réduction de l'impact environnemental et compétitivité à long terme. Élaborée par la communauté PACCT, cette note propose des recommandations concrètes destinées à informer les institutions européennes et à alimenter la future loi sur l'économie circulaire de 2026.
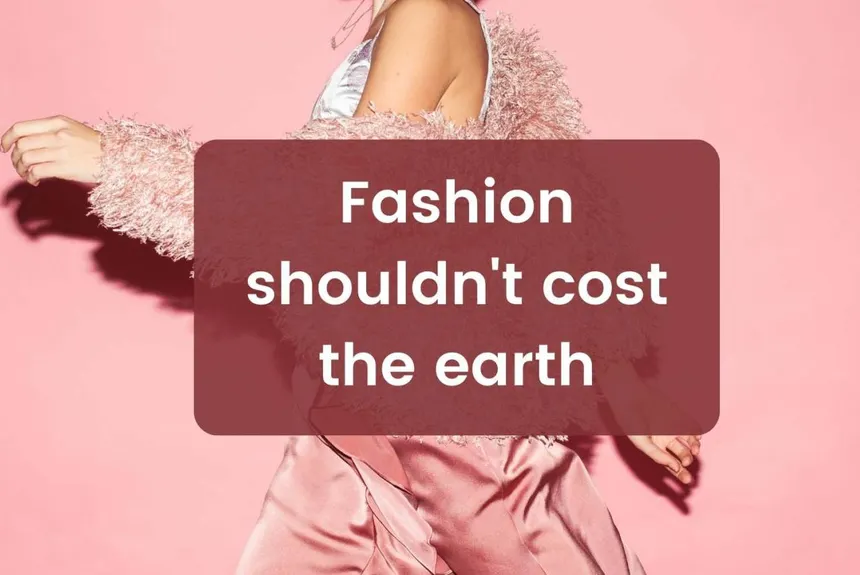
Durabilité des modèles économiques : combien de temps un modèle fondé sur l’infini peut-il tenir dans un monde fini ?
La fast-fashion n’est qu’un symptôme : ce n’est pas Shein le sujet, mais ce que Shein révèle. Et ce que tant d’autres secteurs ont tenté avant elle, du low-cost aérien au modèle freemium numérique, en passant par certaines stratégies industrielles obsédées par l’écoulement massif de volumes. Le vrai problème n’est pas la vitesse. Il n’est même pas la technologie. Il est la cohérence systémique : un modèle peut-il être durable lorsqu’il repose sur une logique d’extraction permanente, de ressources, d’attention, de temps, de main-d’œuvre... sans intégrer les limites physiques, sociales et économiques dans lesquelles il opère ?

Services et soutenabilité : retour critique sur une idée séduisante mais mal comprise
Depuis une quinzaine d’années, l’idée revient avec insistance dans les milieux académiques, industriels et politiques : le passage d’une économie de produits à une économie de services serait une voie royale vers une société plus durable. Des auteurs influents comme Hawken et Lovins ont popularisé cette intuition selon laquelle la “service economy” – centrée sur l’usage plutôt que la possession – permettrait de dématérialiser l’économie et de réduire la pression environnementale. L’équation semble simple : si nous n’achetions que le “service rendu”, et non les objets eux-mêmes, l’industrie pourrait produire moins, produire mieux, et maintenir durablement les artefacts en circulation.


%20(1).jpg)


