Piloter la formation professionnelle : choisir la bonne approche pour transformer durablement son organisation

La formation, levier stratégique et promesse sociale
En vingt-cinq ans, la perception de la formation a profondément évolué dans les entreprises. Autrefois considérée comme un poste de dépense ou un simple outil RH, elle est désormais brandie comme un levier stratégique indispensable. Les dirigeants et les cadres n’hésitent plus à affirmer haut et fort que former ses collaborateurs n’est plus un luxe, mais une nécessité. Dans un monde en perpétuel bouleversement - crises sanitaires, transition écologique, explosion des usages numériques, arrivée de l’IA générative - l’acquisition de nouvelles compétences et la capacité à apprendre deviennent centrales. Pas seulement pour rester compétitif, mais aussi pour attirer les talents, les fidéliser, cultiver l’innovation et ancrer une culture d’entreprise inclusive, éthique et engagée.
Dans ce contexte, la formation n’est plus uniquement au service de la performance : elle devient une composante clé de la promesse employeur. Proposer à ses collaborateurs des parcours de développement sur mesure, investir dans leur employabilité, les aider à grandir dans leur rôle, c’est aussi répondre à un besoin profond de reconnaissance et de sens au travail.
Mais comment structurer cet engagement ? Comment piloter efficacement une politique de formation à la hauteur des enjeux contemporains ? Et surtout : existe-t-il une seule et unique bonne manière de faire ? La réponse, selon une enquête menée auprès de responsables formation dans 69 grandes entreprises internationales, est sans équivoque : non. Il n’existe pas un modèle universel de pilotage de la formation, mais trois grandes approches distinctes, chacune répondant à des contextes et à des objectifs spécifiques.
Trois approches distinctes pour piloter la formation
Les organisations qui réussissent dans leur stratégie de développement des compétences sont celles qui savent aligner leur modèle de pilotage de la formation avec leur culture, leurs priorités stratégiques et leur vision du leadership. À travers l’analyse des pratiques, trois archétypes de responsables formation se distinguent : les gardiens, les progressistes et les médiateurs.
1. Les gardiens : l’alignement stratégique avant tout
Les « gardiens » voient la formation comme un instrument au service de la performance collective. Pour eux, l’objectif prioritaire est clair : renforcer l’efficacité de l’organisation en assurant la conformité aux standards et en consolidant une culture commune. Dans leur vision, toute action de formation doit produire un impact tangible, observable, mesurable, et surtout aligné avec les besoins opérationnels.
Leurs programmes sont conçus pour faire monter les collaborateurs en compétence sur des savoir-faire précis, souvent en lien direct avec des enjeux de transformation, de croissance ou d’optimisation. Ils favorisent des dispositifs éprouvés : boot camps intensifs, simulations, mises en situation proches du réel, retour d’expérience immédiat, apprentissage entre pairs… Le tout, orchestré avec rigueur et piloté par les indicateurs de performance.
Leur approche, que l’on pourrait qualifier de « formation utilitaire », permet de diffuser efficacement une culture managériale commune, d’unifier les pratiques à l’échelle de l’organisation et d’accompagner des changements majeurs, comme le lancement d’une nouvelle stratégie ou la réorganisation d’une business unit. Elle est particulièrement adaptée aux contextes où l’alignement est prioritaire.
Un exemple emblématique ? L’Apple University, mise en place à l’initiative de Steve Jobs, visait précisément à transmettre aux nouvelles générations de managers les principes fondateurs d’Apple — simplicité, design, excellence produit — en formalisant une culture interne forte au service de la cohérence stratégique.
Mais cette approche peut aussi se heurter à ses limites. Trop rigide, elle peut brider la créativité, décourager les talents atypiques et échouer à prendre en compte les aspirations individuelles. Elle est souvent remise en question lorsque l’entreprise traverse une phase où l’agilité et l’innovation deviennent vitales.
2. Les progressistes : libérer le potentiel individuel
À l’opposé du spectre, on trouve les « progressistes ». Leur vision de la formation repose sur une conviction humaniste : tout salarié a droit à un parcours de développement qui lui permet de s’épanouir, d’explorer ses talents et de tracer son propre chemin. Pour eux, la formation n’est pas un levier de conformité, mais une opportunité de croissance personnelle et de liberté d’action.
Leur credo : former, ce n’est pas normaliser — c’est responsabiliser. Ils défendent une conception décentralisée, ouverte, flexible de la formation. Dans leur univers, les collaborateurs deviennent auteurs de leurs apprentissages. Ils choisissent les contenus, les formats, les modalités qui leur conviennent. Ils apprennent à apprendre, par l’expérimentation, l’erreur, la découverte.
Les dispositifs mis en place par les progressistes privilégient les environnements de type « terrain de jeu » plutôt que les parcours formels. Ils misent sur la curiosité, la transversalité, l’hybridation des savoirs. Les intervenants sont souvent des profils extérieurs à l’entreprise, choisis pour leur capacité à ouvrir des perspectives inédites : artistes, penseurs, philosophes, entrepreneurs. L’objectif n’est pas de « former au poste », mais de stimuler des prises de conscience et de révéler le potentiel inexploité des individus.
Cette posture, parfois perçue comme contre-culturelle, séduit pourtant de plus en plus de grandes entreprises en quête d’innovation et de sens. Google en est un parfait exemple. Son ancien DRH, Laszlo Bock, a conçu une approche radicalement libératrice, racontée dans son livre « Work Rules! », où la formation est un droit et l’autonomie, une obligation.
L’approche progressiste fonctionne particulièrement bien dans les contextes où l’entreprise souhaite encourager l’intrapreneuriat, casser des silos, renouveler ses pratiques ou attirer une nouvelle génération de talents. Elle favorise l’engagement, la créativité, la prise d’initiative. Mais elle peut déstabiliser des managers plus classiques ou susciter des tensions si elle n’est pas suffisamment alignée avec la culture dominante.
3. Les médiateurs : construire une communauté apprenante
Le troisième profil, plus rare, est celui des « médiateurs ». Ces responsables de la formation se donnent pour mission de concilier les deux approches précédentes. Ils cherchent à bâtir une communauté de travail où la performance collective et l’épanouissement individuel ne s’opposent pas, mais se nourrissent mutuellement.
Leur vision est systémique. Pour eux, la formation doit contribuer à transformer l’organisation en un lieu d’interdépendance, où l’on apprend les uns des autres, où l’on se développe en contribuant au développement des autres, et où la culture du feedback, du dialogue et de l’intelligence collective devient une ressource stratégique.
Leur approche pédagogique est hybride. Ils alternent des temps d’introspection personnelle, des dispositifs expérientiels collectifs, et des séquences centrées sur les enjeux business. Ils conçoivent des parcours dans lesquels le contenu importe autant que les relations qui se tissent au fil du processus. L’objectif est autant de transmettre des compétences que de créer des ponts entre les équipes, les métiers, les générations ou les zones géographiques.
L’exemple du programme « Transforming Schneider Leadership » illustre parfaitement cette approche. Mis en place sur plusieurs années par la DRH de Schneider Electric, ce programme a permis de fédérer une communauté internationale de cadres autour d’une transformation numérique ambitieuse, en associant boot camps techniques et ateliers collaboratifs autour de la culture d’entreprise.
Les médiateurs sont souvent expérimentés, rompus à la complexité organisationnelle, capables d’arbitrer entre les impératifs de résultats et les enjeux de lien. Leur impact est profond mais souvent lent, car ils doivent naviguer dans des environnements ambigus, gérer des paradoxes, et faire émerger des consensus là où les oppositions semblaient irréconciliables.
Ils sont particulièrement efficaces dans les organisations où l’enjeu est de construire une culture commune forte (fusion, croissance rapide, transformation), de renforcer l’inclusion ou de faire émerger de nouveaux leaders issus de la diversité.
Choisir son approche : une question de contexte, pas de dogme
Ces trois modèles ne sont pas exclusifs les uns des autres. Ils répondent à des besoins différents, selon les moments de vie de l’entreprise, ses priorités, sa culture managériale, et la nature des talents qu’elle souhaite faire grandir.
- L’approche gardienne est pertinente quand il faut créer une base commune, aligner les comportements, diffuser une stratégie ou renforcer la cohérence.
- L’approche progressiste s’impose dans les phases de changement profond, d’exploration, d’innovation, ou lorsqu’il s’agit de séduire une nouvelle génération.
- L’approche médiatrice devient cruciale lorsque l’organisation veut se transformer sans se fracturer, en misant sur les relations et la coopération.
L’erreur fréquente des dirigeants consiste à plaquer une approche unique sur l’ensemble de l’organisation, ou à recruter des responsables de la formation dont les convictions sont en décalage avec les besoins réels de l’entreprise. Il est donc essentiel de prendre le temps de clarifier ce que l’on attend réellement de la formation, à court, moyen et long terme.
Et maintenant, que faire ?
Piloter la formation dans l’entreprise, ce n’est pas seulement choisir des formats et des outils. C’est faire un choix de positionnement, de vision, de valeurs. C’est arbitrer entre conformité et autonomie, entre transmission et exploration, entre efficacité et humanité.
Pour les dirigeants, il est crucial de se poser quelques questions structurantes :
- De quoi notre organisation a-t-elle le plus besoin aujourd’hui : alignement, renouvellement, ou cohésion ?
- Nos priorités stratégiques impliquent-elles plutôt des apprentissages normés ou des apprentissages personnalisés ?
- Quel type de culture voulons-nous renforcer à travers nos actions de formation ?
- Le ou la responsable de formation actuel(le) incarne-t-il/elle l’approche la plus adaptée à notre moment d’entreprise ?
- Comment pouvons-nous combiner les forces de chaque approche pour répondre à la complexité de notre réalité ?
En répondant à ces questions, vous pourrez non seulement mieux structurer vos dispositifs de formation, mais aussi les doter d’un sens et d’une cohérence qui parleront autant aux collaborateurs qu’aux dirigeants.
Former, ce n’est pas remplir un verre vide. C’est allumer un feu. À condition de savoir dans quelle direction souffler.
Note : Profitez-en pour consulter toutes les formations proposées par Service&Sens :
Management | Performance Commerciale | SAV/Service Client | Relation Client | Communication Interne | Sur-mesure
Prêts à développer une stratégie de Croissance Servicielle ?
Êtes-vous prêts à donner un nouvel élan à votre entreprise, à travers une approche orientée Services, une relation clients singulière et fidélisante, un modèle économique disruptif et en phase avec votre politique RSE, une politique managériale adaptée à toutes les générations, une performance commerciale revisitée et durable, et/ou des coopérations clients-fournisseurs-partenaires inédites et à forte valeur ajoutée ?
Chez Service&Sens, nous sommes là pour vous guider dans le développement de votre stratégie de croissance sur mesure, en transformant chacun de vos défis en opportunités concrètes, portées par vos équipes.
Abonnez-vous à Transform'Action News, notre newsletter incontournable !
En vous abonnant, vous aurez un accès privilégié à un monde d'avantages. Tous les deux mois, nous vous partagerons des contenus exclusifs, des analyses prospectives, des actualités de l'industrie, des conseils d'experts et bien plus encore.
Rejoignez notre communauté dynamique et enrichissante dès maintenant en vous abonnant à notre newsletter.
C'est rapide, facile et gratuit. Et souvenez-vous, l'information est le pouvoir.

D'autres articles sur le même sujet

Pourquoi la satisfaction client ne suffit pas à réussir une transformation d’entreprise ?
La satisfaction client est devenue un objectif indiscutable. Mais elle reste un indicateur. Et un indicateur mesure un état passé. Il ne définit pas un cap stratégique.

Les paradoxes organisationnels freinent votre transformation
On associe souvent la transformation organisationnelle à des projets techniques : nouveaux outils, nouveaux process, nouvelles méthodes. Pourtant, les transformations échouent rarement pour des raisons techniques.
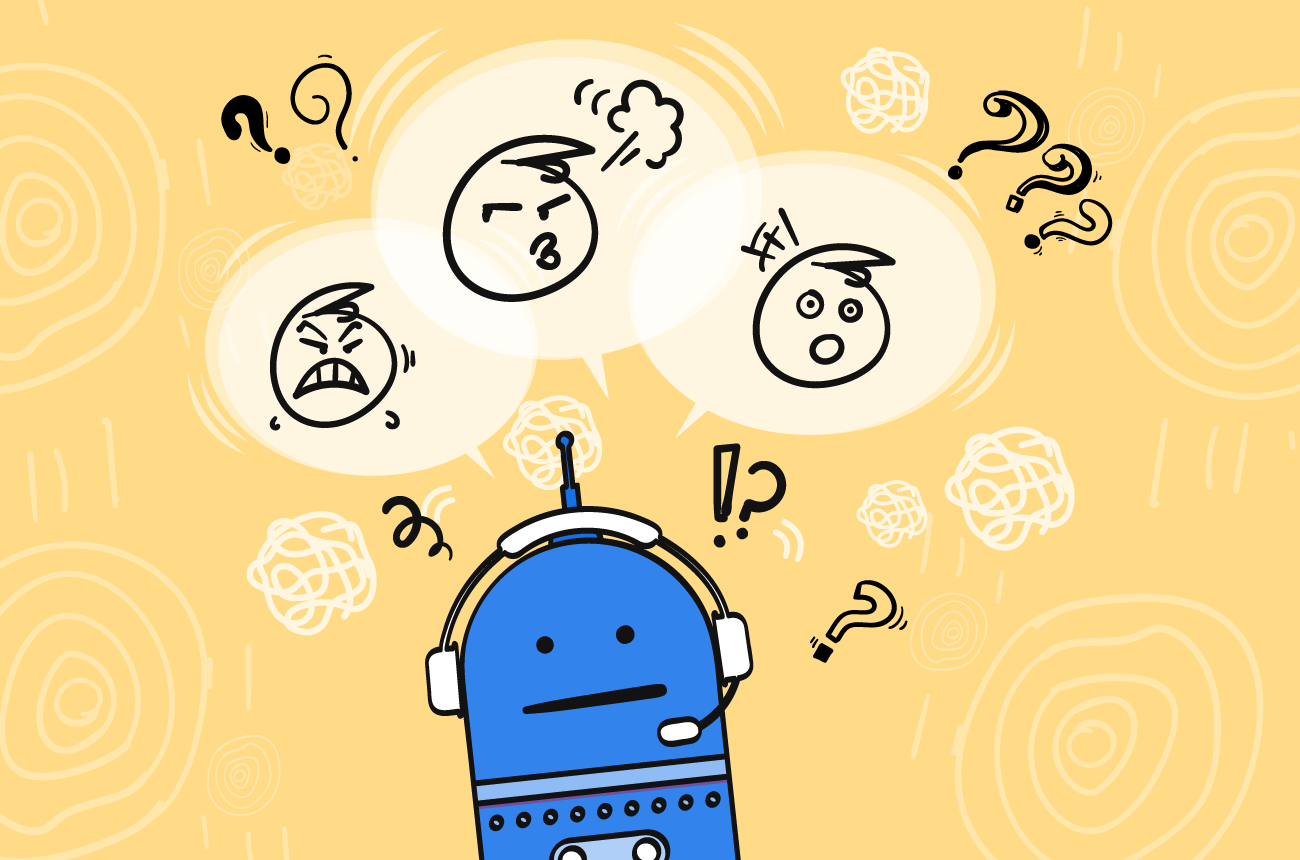
La relation client vue par la Gen Z en France en 2026
De l’assistance à la relation d’équité : un changement de paradigme profond ? Les résultats de l’étude « Les Français et la relation client », menée par Ipsos et Tersea, ne constituent pas un simple baromètre d’attentes consommateurs. Ils révèlent un changement de norme relationnelle : la relation client n’est plus perçue comme un service rendu par la marque, mais comme un espace d’équité à construire.


%20(1).jpg)


