Agentic AI et Agent-Washing : le double défi stratégique pour les entreprises en 2025
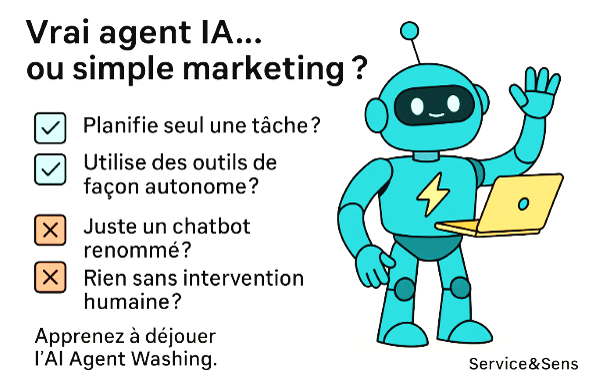
Agentic AI et AI Agent Washing : comprendre, anticiper et sécuriser vos choix en 2025
1. Introduction : promesses d’autonomie et mirages technologiques
Dans l’effervescence actuelle de l’innovation numérique, l’intelligence artificielle semble tout bouleverser. L’arrivée des agents autonomes – ou agentic AI – alimente les espoirs les plus fous : assistants qui gèrent vos mails, agents commerciaux qui négocient seuls, techniciens digitaux qui résolvent vos tickets SAV… Bref, l’IA qui agit, raisonne et décide. Mais cette révolution annoncée est aujourd’hui parasitée par une dérive grandissante : celle de l’AI Agent Washing.
Ce terme, emprunté au greenwashing ou au AI washing, désigne une pratique marketing consistant à faire passer des technologies classiques – chatbots, scripts automatisés, RPA – pour des agents intelligents alors qu’ils ne disposent ni de l’autonomie, ni de la capacité d’adaptation ni du raisonnement requis. Résultat : les promesses ne sont pas tenues, les projets déçoivent, et la confiance des décideurs s’effrite.
Selon une étude de Gartner relayée par Reuters en juin 2025, plus de 40 % des projets « agentiques » seront abandonnés avant 2027, notamment à cause de surventes technologiques et de manque de preuves tangibles d’intelligence réelle. Le marché, saturé de fausses promesses, crée une confusion dangereuse : entreprises désorientées, directions IT sceptiques, budgets gaspillés.
Pourtant, les véritables agents IA – bien conçus, testés, sécurisés – offrent un potentiel immense : coordination automatisée de tâches complexes, interactions naturelles, prise de décision stratégique ou opérationnelle, exécution autonome de tâches à valeur ajoutée. Encore faut-il savoir distinguer le vrai du faux.
Dans cet article, nous allons :
- définir ce qu’est réellement un agent intelligent autonome ;
- identifier les pratiques d’AI Agent Washing et leurs conséquences ;
- explorer des cas concrets ;
- proposer une grille de lecture stratégique pour aider les entreprises à choisir, auditer, déployer ou rejeter des projets « agentiques ».
2. Comprendre l’Agentic AI
2.1 Définition et fonctionnement des agents intelligents
Un agent IA (ou agentic AI) est une entité logicielle dotée de la capacité d’agir de manière autonome dans un environnement donné, en poursuivant un ou plusieurs objectifs, tout en adaptant son comportement en fonction du contexte.
L’agent ne se contente pas de répondre à une requête comme le ferait un moteur de recherche ou un assistant vocal. Il :
- perçoit des informations via des capteurs ou API (inputs) ;
- raisonne en s’appuyant sur des modèles cognitifs ou des chaînes de pensée (CoT) ;
- planifie une séquence d’actions pour atteindre son but ;
- agit de manière proactive, avec la capacité de boucler, réessayer, s’auto-corriger.
Ce cycle perception–raisonnement–action est la marque de l’agentic AI, qui se différencie des simples modèles conversationnels (LLMs) ou des systèmes RPA (robotic process automation).
2.2 Exemples récents
Parmi les initiatives notables en 2025 :
- AutoGPT, BabyAGI, AgentGPT : agents open-source expérimentaux qui planifient des tâches à partir d’une consigne utilisateur.
- GPT-4o (OpenAI) : architecture multimodale, capable de mener des actions dans un environnement connecté à des API, mais sous contrôle utilisateur.
- Claude Sonnet (Anthropic) : gestion d’objectifs et planification dynamique via constitution d’une mémoire étendue de contexte.
- Devin (Cognition AI) : agent développeur capable de coder, tester et corriger ses programmes pour accomplir un projet logiciel.
Ces projets explorent différents degrés d’autonomie. Certains sont "tool-using" (utilisent des outils externes), d'autres sont "multi-agents", capables de déléguer à d'autres agents.
Mais attention : ces solutions restent en grande partie expérimentales. Très peu d’entre elles atteignent la maturité opérationnelle nécessaire pour des déploiements industriels. Et c’est là que le "washing" commence.
3. Décryptage du phénomène d’AI Agent Washing
3.1 Définition
L’AI Agent Washing consiste à présenter comme agents IA des systèmes qui ne le sont pas réellement.
Exemples typiques :
- un chatbot pré-entraîné, sans mémoire ni capacité de planification, est présenté comme un "agent conversationnel autonome" ;
- un script RPA exécutant des actions sur un logiciel est qualifié d’"IA assistante" ;
- un système de règles (if/then) est vendu comme une solution d’agent intelligent proactif ;
- une interface "humaine" (voix, 3D, avatar) masque un moteur basique sans logique adaptative.
Cette pratique pose problème car elle :
- trompe le client sur la nature réelle du produit ;
- induit des erreurs stratégiques dans le choix et l’intégration de la solution ;
- nuit à l’ensemble de l’écosystème IA, en semant la confusion et en réduisant la crédibilité des véritables acteurs du domaine.
3.2 Un phénomène en pleine expansion
D’après Bernard Marr (Forbes, 11 juillet 2025), la multiplication des projets IA et la pression concurrentielle ont poussé de nombreux fournisseurs à survendre leurs produits, sous l’étiquette « agentique ». Résultat : on estime à seulement 130 le nombre de vendors réellement « agentics » sur les milliers de prestataires revendiquant cette capacité.
Une étude menée par le cabinet DWF en avril 2025 montre que 27 % des solutions présentées comme des agents IA ne passent aucun test de planification autonome, et 19 % ne disposent d’aucun moteur de raisonnement ou d’apprentissage intégré.
Le terme devient un label marketing vide, parfois volontairement flou. Or, dans un contexte de tension réglementaire (AI Act européen, SEC américaine, FCA britannique), le recours à un vocabulaire exagéré ou trompeur peut avoir des conséquences juridiques lourdes, comme on le verra plus loin.
4. Pourquoi l’AI Agent Washing est un risque stratégique pour les entreprises
Si l’AI agent washing peut sembler à première vue n’être qu’un excès marketing bénin, ses implications peuvent s’avérer particulièrement lourdes pour une entreprise. Car au-delà de la déception technologique, ce sont bien la performance, la conformité, la sécurité et la crédibilité de l’entreprise qui sont en jeu.
4.1 Perte de confiance, réputation entachée
Un projet IA qui échoue, ce n’est pas qu’un surcoût : c’est un signal négatif envoyé à toutes les parties prenantes. Qu’il s’agisse d’un agent de recrutement IA incapable de discriminer correctement les candidatures, d’un pseudo-agent conversationnel incapable d’apporter de la valeur en SAV, ou d’un outil supposé “auto-exécutif” nécessitant en réalité des validations humaines constantes, l’échec laisse des traces.
Dans une étude de Deloitte de mai 2025, 47 % des responsables métiers interrogés affirment avoir revu à la baisse leur confiance dans les projets IA autonomes, après une expérience déceptive liée à une promesse non tenue. Le phénomène s’accélère dans les entreprises où les équipes métiers sont peu sensibilisées aux différences entre agents, assistants et automatisation simple.
Or, dans une dynamique d’innovation, la confiance est un actif immatériel essentiel : sa perte ralentit l’adoption des vraies technologies à forte valeur ajoutée, pousse à la frilosité budgétaire, et renforce les résistances internes.
4.2 Risques juridiques et réglementaires
La réglementation autour de l’intelligence artificielle se structure rapidement. L’Union européenne, à travers l’AI Act (promulgué en 2024), impose déjà des obligations de transparence, traçabilité, explication et validation des systèmes autonomes.
Outre les exigences de conformité, les autorités de régulation peuvent sanctionner le recours à des termes trompeurs ou à des pratiques fallacieuses :
- La SEC (États-Unis) a sanctionné en 2024 les entreprises Delphia et Global Predictions pour “AI Washing”, avec des amendes allant jusqu’à 400 000 $ pour avoir communiqué à leurs investisseurs des informations mensongères sur l’autonomie de leurs systèmes prédictifs.
- L’ASA britannique (Advertising Standards Authority) a quant à elle ouvert une enquête en 2025 sur plusieurs entreprises tech ayant vendu des assistants comme “agents d’exécution” sans capacités prouvées d’action autonome.
- La FCA et la CMA britanniques intègrent désormais la notion d’"AI misleading labelling" dans leurs lignes directrices en matière de conformité produit.
Les litiges sont donc bien réels, y compris dans des secteurs non-tech : santé, assurance, banque, RH. Toute promesse d’autonomie engage la responsabilité de l’entreprise, surtout si l’agent est impliqué dans une prise de décision affectant un client ou un salarié.
4.3 Risques opérationnels : erreurs, biais, dérapages
Un agent IA qui n’est en réalité qu’un automate mal étiqueté est un danger opérationnel. Pourquoi ? Parce que les équipes lui font confiance pour des tâches qu’il ne sait pas réellement exécuter.
Conséquences :
- Décisions prises sans supervision, sur la base de règles obsolètes ou mal calibrées ;
- Propagation de biais, lorsque l’agent est censé « apprendre » mais n’a pas de moteur adaptatif ;
- Fuites de données, si des API externes non vérifiées sont utilisées pour simuler une autonomie ;
- Performance en chute libre, dès que la tâche sort du cadre prévu par les scripts.
Ainsi, de nombreuses entreprises finissent par désactiver ou marginaliser des agents après quelques semaines, au profit d’un retour à l’humain ou à un système semi-automatisé.
5. Détecter les signaux faibles du "washing" : la check-list pour décideurs
Comment une entreprise peut-elle détecter une situation d’AI agent washing avant qu’il ne soit trop tard ? Plusieurs indicateurs permettent de faire le tri entre véritable agent autonome et produit rebrandé.
5.1 Les signaux d’alerte techniques et fonctionnels
Voici une check-list des points à vérifier systématiquement lorsqu’un fournisseur vous présente une solution "agentique" :
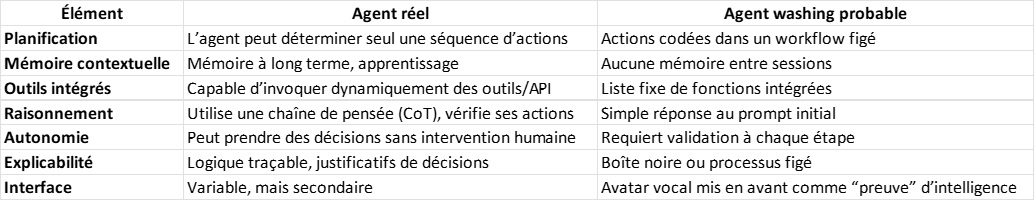
Si plus de trois cases tombent dans la colonne droite : c'est un red flag, le danger est réel.
5.2 Les questions clés à poser aux fournisseurs
Pour éviter d’être pris au piège, posez des questions techniques précises, notamment :
- “Votre agent peut-il planifier des séquences d’actions ?”
- “Utilise-t-il un modèle de raisonnement explicite (ex. : chain-of-thought, tree-of-thought) ?”
- “Peut-il décider de modifier son plan en fonction de l’environnement ?”
- “Dispose-t-il d’une mémoire de travail persistante ?”
- “Quels outils (API, scripts, apps) l’agent peut-il appeler de façon autonome ?”
La règle : moins le fournisseur comprend la question, plus vous êtes face à un pur produit marketing.
6. Études de cas : entre promesses brillantes et revers douloureux
6.1 Amazon Just Walk Out : quand l’agent est un humain
Amazon a longtemps promu son service “Just Walk Out” dans ses magasins physiques comme une prouesse de computer vision et d’agents autonomes. Les clients étaient censés “entrer, prendre leurs produits, et ressortir” pendant qu’un système agentique les suivait, détectait leurs choix et gérait automatiquement la facturation.
Mais en 2024, un article du site The Information révèle que le système repose à plus de 80 % sur des employés humains situés à distance en Inde, qui regardent les vidéos et valident les achats en temps réel.
Ce scandale a révélé un cas massif de “agent washing humain” : une technologie vendue comme agent autonome était en réalité un processus semi-manuel déguisé.
Résultat :
- Fermeture de plusieurs magasins “Just Walk Out” ;
- Perte de crédibilité sur les offres IA d’Amazon ;
- Questions juridiques sur la protection des données personnelles et la transparence client.
6.2 Anthropic et Claude Sonnet : entre innovation et attentes mal calibrées
Anthropic a lancé avec fracas son agent Claude 3 Sonnet en 2025, présenté comme une avancée majeure dans l’autonomie des agents conversationnels. Pourtant, plusieurs tests indépendants ont montré que l’agent :
- restait fortement dépendant du prompt initial ;
- ne faisait pas de boucle de décision complexe ;
- nécessitait des relances fréquentes pour accomplir une tâche multi-étapes.
Bien que Claude 3 Sonnet soit techniquement avancé, il ne correspondait pas à la définition stricte d’un agent autonome exécuteur de tâches, comme l’a précisé un rapport du MIT Technology Review.
6.3 Sanctions par la SEC : les cas Delphia et Global Predictions
En mars 2024, la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a sanctionné deux entreprises fintech, Delphia et Global Predictions, pour avoir exagéré les capacités d’agents IA dans leurs offres d’investissement automatisé.
Les communiqués de presse parlaient d’“agents décisionnels”, “intelligents, proactifs, adaptatifs”, alors que les produits proposés étaient en réalité de simples algorithmes de recommandation paramétrés à l’avance.
Résultat :
- Sanctions financières (400 000 dollars cumulés) ;
- Retrait temporaire de certains produits ;
- Outils désormais sous supervision réglementaire renforcée.
7. Cadre stratégique pour repérer et éviter l’AI Agent Washing
Face à la montée de l’AI Agent Washing, les entreprises doivent structurer leur vigilance. L’approche ne peut être laissée au seul département IT ou innovation : elle doit impliquer la gouvernance, la conformité, les directions métiers, le juridique, et parfois même les RH.
7.1 Due diligence renforcée
Avant tout engagement avec un fournisseur, une démarche de due diligence IA s’impose. Celle-ci peut s’articuler autour des dimensions suivantes :
- Technique : vérification de l’architecture, présence d’un moteur de planification, raisonnement, capacité de multi-agent, logs d’exécution.
- Fonctionnelle : mesure de l’autonomie réelle, de la flexibilité face aux scénarios inattendus, de la capacité à gérer les exceptions.
- Sécuritaire : protection des données, cloisonnement des contextes, auditabilité.
- Légale : conformité avec l’AI Act, l’accessibilité, le RGPD, et la communication non mensongère.
- Éthique : mécanismes de supervision, transparence, explicabilité, niveau de contrôle humain.
Bonnes pratiques :
- Demander un livre blanc technique.
- Vérifier les journaux de tâches ou traces d’exécution.
- Réaliser une analyse de risques différenciée selon les cas d’usage.
7.2 Tests progressifs et preuve de valeur (POC)
Un agent IA ne se valide pas sur une démo. Il faut tester en contexte réel, selon une démarche progressive :
- POC ciblé, sur un cas métier concret et mesurable ;
- MVP fonctionnel, avec utilisateurs pilotes ;
- Évaluation multicritère : performance, autonomie, robustesse, adoption utilisateur ;
- Scénarios inverses : que fait l’agent en cas d’ambiguïté, d’erreur de contexte, ou de manque d’information ?
Les critères doivent être définis avant la phase de test, pas après. Sans cela, les biais de confirmation prennent le dessus.
7.3 Pilotage et traçabilité
Une fois déployé, l’agent doit rester sous gouvernance active. Cela implique :
- supervision humaine (human-in-the-loop ou human-on-the-loop) ;
- indicateurs de performance clairs : taux de réussite, réactivité, qualité perçue, nombre d’escalades humaines ;
- tracabilité des décisions prises ;
- logs d’activité disponibles et exploitables ;
- droits d’audit par un tiers (notamment en cas d’externalisation ou d’achat en marque blanche).
Cette gouvernance différencie les agents "fiables" des gadgets marketing. Elle rassure aussi les régulateurs et les comités d’audit.
8. Bonnes pratiques de mise en œuvre d’agents autonomes
Certaines entreprises ont déjà établi des pratiques inspirantes dans la mise en œuvre d’agents IA, en contournant les pièges de l’AI washing.
8.1 Instaurer un cadre de gouvernance interfonctionnel
La gouvernance ne peut être purement technique. Une cellule de pilotage transverse, rattachée au COMEX, incluant DSI, juridique, métiers, conformité et direction générale, est un facteur clé de succès.
Exemples de bonnes pratiques :
- Comité de validation éthique (comme chez AstraZeneca) ;
- Grilles de niveaux d’autonomie utilisées par Schneider Electric pour classer les agents ;
- Charte de transparence IA, rédigée avec les utilisateurs finaux.
8.2 Accompagner les utilisateurs, former les métiers
Un agent IA modifie les rôles. Si les utilisateurs n’en comprennent ni la logique, ni les limites, la confiance s’effondre.
Recommandations :
- former les collaborateurs aux capacités et limites des agents ;
- intégrer les utilisateurs dans les phases de test et de feedback ;
- mettre en place une fonction de référent agent dans chaque BU ;
- anticiper les impacts RH (requalification, montée en compétence, repositionnement).
Exemple : la SNCF a lancé en 2024 une série de formations "agentic literacy" pour les managers, afin de leur permettre d’identifier les projets d’IA washing et de dialoguer avec les équipes tech.
8.3 Choisir les architectures adaptées
Le choix de l’architecture technique conditionne le niveau d’autonomie :
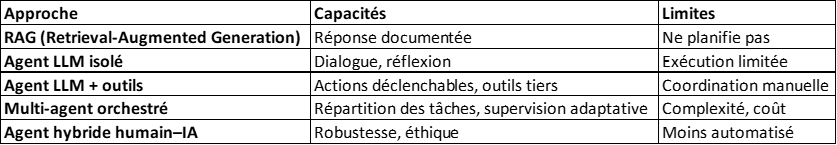
De plus en plus d’entreprises optent pour des architectures multi-agents + supervision humaine, où chaque composant reste simple, mais la coordination génère de l’intelligence collective.
9. Enjeux futurs et tendances à horizon 2028
9.1 Explosion des cas d’usage (réels ou fantasmés)
Selon IDC et McKinsey, d’ici 2028 :
- plus de 30 % des applications SaaS intégreront un ou plusieurs agents autonomes ;
- 15 à 25 % des décisions de gestion opérationnelle seront prises (ou préparées) par des agents ;
- les dépenses mondiales en agentic AI atteindront plus de 180 milliards de dollars.
Mais cette expansion rapide crée un terrain fertile pour le washing, tant que des standards clairs ne sont pas imposés.
9.2 Vers des labels ou certifications ?
L’absence de standard nuit à la lisibilité du marché. À ce titre, plusieurs initiatives émergent :
- Consortium Agentic Trust (lancé en 2025 par Microsoft, Anthropic, Hugging Face) ;
- Label européen "AI transparency by design" en cours de définition ;
- Travaux du IEEE sur les niveaux d’autonomie et d’explicabilité.
À terme, un indice de maturité agentique pourrait devenir obligatoire dans les appels d’offres publics et les audits IA réglementaires.
9.3 L’essor de l’agentic ops
La maturité ne passera pas uniquement par la technologie, mais par les organisations capables d’absorber et d’encadrer des agents dans leurs processus internes.
Le modèle "Agentic Ops" pourrait devenir un standard :
- process documentés pour chaque interaction agent–humain ;
- tableaux de bord de pilotage IA ;
- indicateurs de supervision active ;
- mise à jour régulière du socle d’outils et de rôles ;
- agents coordonnés, mais sous contraintes métier.
10. Conclusion : vigilance, stratégie, transparence
Le développement de l’IA agentique est sans conteste l’un des tournants majeurs des stratégies numériques des entreprises d’ici 2030. Mais cette promesse est aujourd’hui parasitée par un phénomène croissant : celui de l’AI Agent Washing.
Sous couvert d’innovation, certaines offres n’apportent ni autonomie, ni valeur, ni transparence. Pire, elles peuvent faire perdre du temps, de l’argent et de la crédibilité aux entreprises.
Pour éviter cela, il faut :
- Savoir ce qu’est vraiment un agent IA : percevoir, raisonner, agir.
- Identifier les signaux faibles du washing : manque de mémoire, de planification, d’autonomie réelle.
- Adopter un cadre stratégique rigoureux : due diligence, POC, supervision active.
- Former les équipes et sensibiliser les décideurs.
- Contribuer à la construction d’un écosystème agentique crédible, éthique et sécurisé.
L’entreprise qui saura distinguer les vrais agents des avatars de façade prendra une longueur d’avance. Non seulement dans la maîtrise technologique, mais aussi dans la confiance qu’elle inspirera à ses collaborateurs, ses clients et ses partenaires.
Prêts à développer une stratégie de Croissance Servicielle ?
Êtes-vous prêts à donner un nouvel élan à votre entreprise, à travers une approche orientée Services, une relation clients singulière et fidélisante, un modèle économique disruptif et en phase avec votre politique RSE, une politique managériale adaptée à toutes les générations, une performance commerciale revisitée et durable, et/ou des coopérations clients-fournisseurs-partenaires inédites et à forte valeur ajoutée ?
Chez Service&Sens, nous sommes là pour vous guider dans le développement de votre stratégie de croissance sur mesure, en transformant chacun de vos défis en opportunités concrètes, portées par vos équipes.
Abonnez-vous à Transform'Action News, notre newsletter incontournable !
En vous abonnant, vous aurez un accès privilégié à un monde d'avantages. Tous les deux mois, nous vous partagerons des contenus exclusifs, des analyses prospectives, des actualités de l'industrie, des conseils d'experts et bien plus encore.
Rejoignez notre communauté dynamique et enrichissante dès maintenant en vous abonnant à notre newsletter.
C'est rapide, facile et gratuit. Et souvenez-vous, l'information est le pouvoir.

D'autres articles sur le même sujet
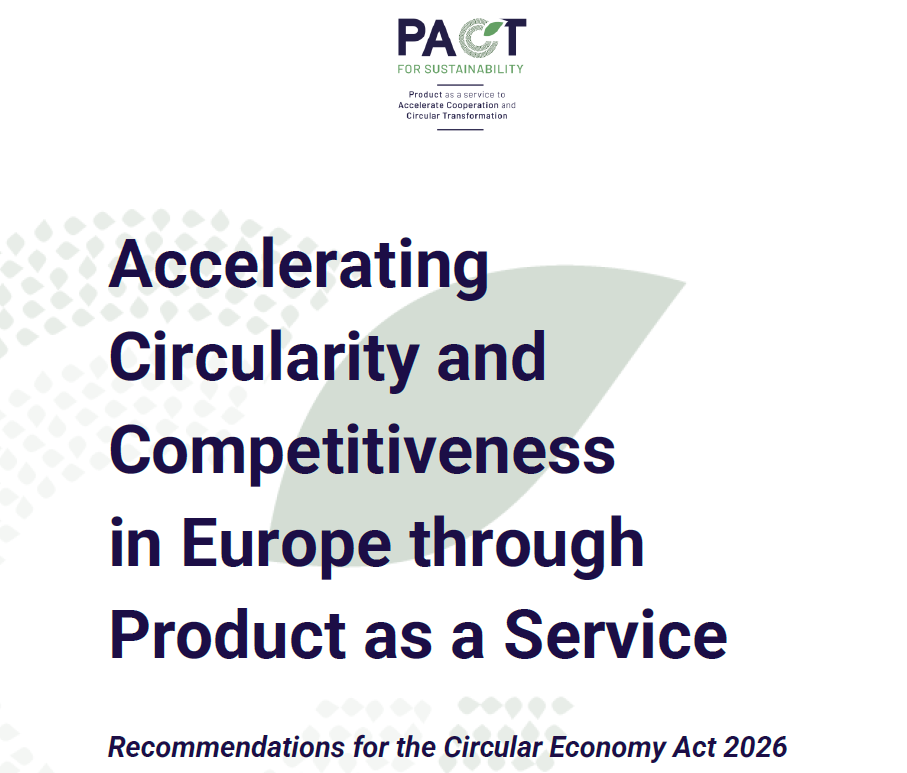
Accélérer la circularité et la compétitivité en Europe grâce au modèle « produit en tant que service »
Juin 2025 : Note d'orientation « Accélérer la circularité et la compétitivité en Europe grâce au modèle « produit en tant que service » Alors que l'UE vise à doubler son taux de circularité, le faisant passer de 12 % à 24 % d'ici 2030, cette note d'orientation souligne comment les modèles économiques de type « produit en tant que service » (PaaS) peuvent jouer un rôle clé en combinant réduction de l'impact environnemental et compétitivité à long terme. Élaborée par la communauté PACCT, cette note propose des recommandations concrètes destinées à informer les institutions européennes et à alimenter la future loi sur l'économie circulaire de 2026.
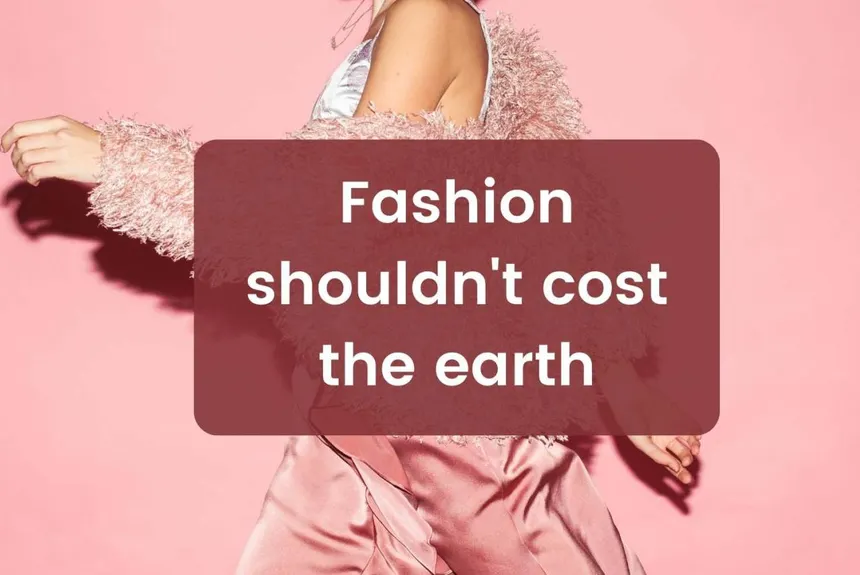
Durabilité des modèles économiques : combien de temps un modèle fondé sur l’infini peut-il tenir dans un monde fini ?
La fast-fashion n’est qu’un symptôme : ce n’est pas Shein le sujet, mais ce que Shein révèle. Et ce que tant d’autres secteurs ont tenté avant elle, du low-cost aérien au modèle freemium numérique, en passant par certaines stratégies industrielles obsédées par l’écoulement massif de volumes. Le vrai problème n’est pas la vitesse. Il n’est même pas la technologie. Il est la cohérence systémique : un modèle peut-il être durable lorsqu’il repose sur une logique d’extraction permanente, de ressources, d’attention, de temps, de main-d’œuvre... sans intégrer les limites physiques, sociales et économiques dans lesquelles il opère ?

Services et soutenabilité : retour critique sur une idée séduisante mais mal comprise
Depuis une quinzaine d’années, l’idée revient avec insistance dans les milieux académiques, industriels et politiques : le passage d’une économie de produits à une économie de services serait une voie royale vers une société plus durable. Des auteurs influents comme Hawken et Lovins ont popularisé cette intuition selon laquelle la “service economy” – centrée sur l’usage plutôt que la possession – permettrait de dématérialiser l’économie et de réduire la pression environnementale. L’équation semble simple : si nous n’achetions que le “service rendu”, et non les objets eux-mêmes, l’industrie pourrait produire moins, produire mieux, et maintenir durablement les artefacts en circulation.


%20(1).jpg)


